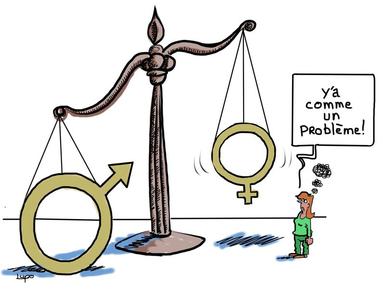Margaret Maruani est sociologue et directrice de recherche au CNRS. Elle analyse ici les inégalités et leurs évolutions dans le marché du travail. Nous reprenons ici un article publié sur « La petite BAO » (Solidaires).
Cet article est un plaidoyer contre deux idées fausses. En premier lieu, il s’attaque à celle-ci : Les inégalités entre hommes et femmes ? Résiduelles, dit-on, nous sommes sur la bonne voie. Mais non, il faut le dire et le répéter, il n’y a pas de pente naturelle vers l’égalité. C’est l’inégalité qui demeure l’évidence. Ses frontières sont mouvantes, certes, mais elles se déplacent plus qu’elles ne s’effacent. Elles se cumulent, s’entrecroisent et se redéploient. Et puis, immédiatement après ou avant, celle-là : Le travail, cet obscur objet de recherche serait devenu ringard. Cela fait près de quarante ans que nous entendons ce petit couplet, sous des vocables divers. Et il laisse toujours aussi perplexe : comment peut-on vivre dans des sociétés où le chômage constitue une préoccupation sociale majeure et affirmer que la réflexion sur le travail et l’emploi est périmée, dépassée, hors-sujet ? Il y a là comme un défaut de logique. Mais au-delà, est-ce si secondaire ou accessoire que de traiter du chômage et du sous-emploi, de la précarité et de la pauvreté laborieuse, des écarts de salaire et de retraite, des restructurations et de leurs cortèges de destructions d’emplois et de vies fêlées, des discriminations racistes et du harcèlement sexuel au travail ? De l’évolution des métiers et de l’avenir du salariat ? Je ne le pense pas. Ces thèmes sont au coeur de la question sociale et nous intéressent justement pour cette raison. Le travail, l’emploi, le chômage ne sont pas des objets désuets. Ce sont des interrogations centrales pour qui s’intéresse à l’égalité entre hommes et femmes, pour qui se penche sur tous les clivages sociaux : ces hiérarchies de genre, de classe, de race et de nationalité qui traversent et façonnent nos sociétés.
Contrastes et contradictions
Et justement, que peut-on dire aujourd’hui, ici et maintenant ? En ce début de XXIe siècle, la situation des femmes sur le marché du travail est faite de paradoxes, de contrastes, de contradictions. On assiste à une transformation sans précédent de la place des femmes dans le salariat qui ne s’est pas accompagnée d’un déclin conséquent des inégalités. La période récente, celle qui va de la deuxième moitié du XXe siècle à aujourd’hui est marquée par des brèches, des stagnations et des régressions.
Quarante ans de chômage et de rationnement du travail n’ont pas entamé la poursuite du mouvement de féminisation du salariat. La continuité de la vie professionnelle des femmes semble désormais inscrite dans les comportements d’activité à la manière d’une norme sociale dominante. Pour autant, ces mutations majeures n’ont pas cassé les mécanismes de production des inégalités de sexe. À côté des formes anciennes d’inégalité professionnelle (écarts de salaires, différences de carrières, ségrégations horizontales et verticales), de nouvelles modalités de disparités ont vu le jour : la création de noyaux durs de chômage et de sous-emploi féminins solidement installés dans certains secteurs — et largement tolérés. La crise de l’emploi n’a pas chassé les femmes de l’emploi, mais elle a considérablement durci les conditions dans lesquelles elles travaillent. L’activité féminine prospère, donc, mais à l’ombre du sous-emploi et du travail à temps partiel. Même s’il y a plus de femmes qualifiées, même s’il y a plus de mélanges dans les professions dites « supérieures », sur le marché du travail, féminisation ne rime toujours pas avec mixité, ni avec égalité.
Brèches
Depuis le début des années 1960, en France comme partout en Europe, on assiste à une croissance spectaculaire de l’activité féminine pendant que l’emploi masculin est frappé d’immobilisme ou de déclin. C’est dans ces années que démarre le mouvement de féminisation de la population active qui se poursuit de nos jours. Que nous disent ces chiffres ? De 1901 à ce début de XXIe siècle, la population active est passée de près de 7 à 14 millions pour les femmes et de 13 à 16 millions pour les hommes : Une lame de fond du côté des femmes, un petit clapotis du côté des hommes. Les femmes représentaient le tiers des forces de travail dans les années 1960, elles en constituent désormais près de la moitié. Telle est la première mutation majeure.
La « percée » des filles à l’école et à l’université, leur réussite scolaire constituent le second fait marquant de la fin du XXe siècle. A l’école comme à l’université, les filles réussissent mieux que les garçons : depuis 1971, les bachelières sont plus nombreuses que les bacheliers ; à partir de 1975, le nombre d’étudiantes égale puis dépasse celui des étudiants. C’est un évènement, déterminant lui aussi.
Plus actives et plus diplômées, les femmes devraient, en toute logique, être les égales des hommes sur le marché du travail. Il n’en est rien.
Stagnations et régressions
Le monde du travail n’est toujours pas mixte. Il est parcouru de ségrégations et de discriminations en tous genres. La féminisation de la population active n’a pas débouché sur une réelle mixité professionnelle. La progression de l’activité et des scolarités féminines s’est traduite, sur le marché du travail, par l’accès d’un certain nombre de femmes à des professions qualifiées et par la féminisation massive… des métiers féminins peu valorisés socialement. Le mouvement est donc double : on assiste à une forte augmentation du nombre de femmes cadres, même si dans ces fonctions elles ne sont pas les égales des hommes. À l’autre extrémité de la pyramide sociale, l’afflux des femmes actives s’est concentré sur les emplois non qualifiés du tertiaire. On assiste ainsi à une sorte de bipolarisation : entre femmes, les écarts se sont creusés. La progression du nombre de femmes cadres et ingénieures cohabite avec le sous-emploi des caissières et le surchômage des ouvrières, les bas salaires des travailleuses pauvres et les petites pensions de nombreuses retraitées.
Le sur-chômage féminin qui a prévalu pendant plusieurs décennies a commencé à s’estomper dans les années 2007-2008 pour s’effacer à partir de 2013 : les femmes sont désormais légèrement moins au chômage que les hommes – sauf chez les ouvrier.es. Mais elles sont majoritaires dans le sous-emploi. Or le sous-emploi est, avec le chômage et son halo, un des indicateurs de la pénurie d’emploi – mais un indicateur discret et méconnu. Au sens où le BIT l’entend et l’INSEE le mesure, le sous-emploi comprend les personnes « qui travaillent involontairement moins que la durée normale du travail dans leur activité et qui étaient à la recherche d’un travail supplémentaire et disponibles pour un tel travail ». C’est ce que l’on appelle le sous-emploi visible, c’est-à-dire celui qui se déclare et peut être comptabilisé comme tel. En Allemagne, cela s’appelle les mini-jobs et concerne des millions de personnes, dont une majorité de femmes – et c’est une pièce maitresse de ce que l’on nomme parfois le « modèle allemand », modèle si l’on veut…
C’est une population qui voisine, jouxte et parfois empiète sur celle des « travailleurs pauvres » et des « bas salaires » – sans se confondre avec elle. Tout comme les working poor [1], les personnes en sous-emploi sont des gens qui travaillent sans parvenir à gagner leur vie de façon décente. Le sous-emploi constitue ainsi une sorte de frange invisible de la population qui subit les dégâts de la pénurie d’emplois. En 2017, la France compte près de 1,7 million de personnes en situation de sous-emploi, dont plus de 1,2 million de femmes et près de 500 000 hommes. Depuis 1990 – date à laquelle l’Insee a entrepris de comptabiliser le sous-emploi – cette catégorie n’a cessé de croître [2]. Qui sont-ils, qui sont-elles ? De fait, la majorité des personnes en sous-emploi sont tout simplement des femmes qui sont à temps partiel et qui souhaiteraient travailler davantage. On y compte aussi les personnes, hommes et femmes, bien moins nombreuses, en situation de chômage partiel.
Cette forte progression du sous-emploi est très étroitement liée à la multiplication des emplois à temps partiel qui a enclenché un processus de paupérisation : le développement d’une frange de population active qui ne sont ni chômeurs, ni exclus, ni assistés mais qui travaillent sans parvenir à gagner leur vie. Dans leur grande majorité, ce sont des femmes qui travaillent à temps partiel. Cette forme d’emploi que l’on décrète bien trop souvent comme « bien pour les femmes » est pourtant ce qui fait le lit des bas salaires, ces revenus du travail qui, à la fin du mois rapportent moins, voire beaucoup moins que ce que la société définit comme le salaire minimum – le SMIC.
Qu’en est-il du côté des salaires ? L’évolution, en la matière est bien lente. En dépit des droits et des lois, les écarts de salaire entre femmes et hommes résistent. En moyenne, tous temps de travail confondus, ils se situent à 24%, en équivalent temps plein (c’est-à dire en effaçant l’effet temps partiel) à 17% et « toutes choses égales par ailleurs » entre 8 et 10%. Ajoutons à cela que sur les 1,6 millions de personnes payées au SMIC, les deux tiers sont des femmes [3].
Tout cela se retrouve, et de façon amplifiée, à l’heure de la retraite. Là aussi, il faut plusieurs chiffres pour comprendre la situation : l’écart entre les retraites des femmes et des hommes est de 39% si l’on considère les pensions de droit direct (ce qui est acquis en contrepartie des années de travail), et de 25% si l’on se base sur les retraites globales (celles qui comprennent les droits dérivés dont les pensions de reversion). Tous comptes fait, cela donne : 1065 euros pour les femmes et 1 739 euros pour les hommes dans le premier cas, 1 322 euros pour les unes et 1 760 pour les autres dans le second cas [4]. Sur le front des « petites retraites », les femmes sont aux avant-postes.
En conclusion
Plus instruites et plus diplômées que les hommes à vingt ans, les femmes sont moins qualifiées et moins payées dès qu’elles arrivent dans le monde du travail et bien plus pauvres quand l’heure de la retraite sonne. S’agirait-il d’un simple décalage dans le temps ? D’un retard qui finira bien par s’estomper dans le temps ou se diluer dans la modernité ? La fable du retard, il faut bien le reconnaitre n’est plus crédible aujourd’hui.
1 PONTHIEUX (Sophie)., « Les travailleurs pauvres : identification d’une catégorie », Travail, Genre et Sociétés, n° 11, 2004.
2 Cf. Emploi, chômage, revenus du travail, INSEE Référence, Edition 2017
3 idem
4 « Les retraités et la retraite », Panoramas de la DREES, édition 2018
![]()